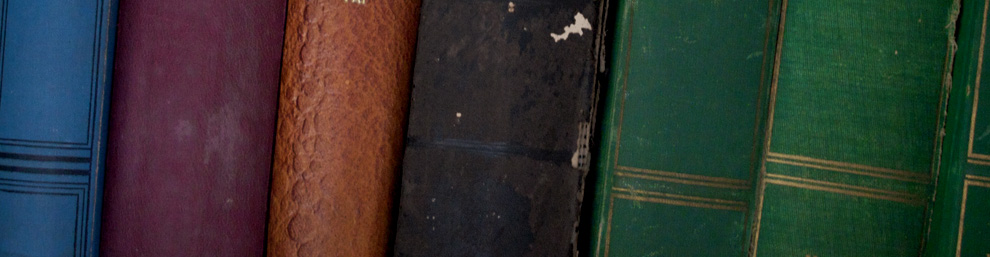Texte écrit dans le blog d’Ancône Culture et Patrimoine et paru le 8 février dernier. Voici un re-blog personnalisé.
Prochaine sortie pédestre patrimoniale d’Ancône Culture et Patrimoine à la découverte du Prieuré d’Aleyrac, à la limite entre la plaine de la Valdaine et du pays de Grignan, non loin d’un petit col qu’empruntèrent jadis, en 1987 entre autre, les Géants du Tour de France après un détour chronométré sur le Géant de Provence.
L’affichette de la sortie signée Paule.
Jeudi 22 février 2018, à partir de Salles-sous-Bois jusqu’au Prieuré puis retour en descente vers la vallée. 15 kilomètres, 400 mètres de dénivelé. Départ à 8h.30 d’Ancône, devant l’Agence postale de Denise.
Mais qu’est-ce qu’un Prieuré ? C’est un monastère dépendant d’une Abbaye plus importante. Le Prieuré est placé sous l’autorité d’un prieur, lui-même dépendant d’un abbé… de l’Abbaye. Elémentaire mon cher Watson !
Sauf qu’à Aleyrac, ce n’était pas un prieur qui dirigeait le Prieuré mais une religieuse-prieur (une prieuse ?). Car Aleyrac était un monastère bénédictin qu’occupaient treize nonnes. Nous sommes là au XIIème siècle, c’est-à-dire vers 1100. Ce Prieuré dépend de la prospère abbaye de l’Ile-Barbe à Lyon, cette île jetée au milieu de la Saône au nord de la Croix Rousse.
Ainsi vivait cette communauté de femmes murée dans le silence pour suivre les règles fixées par Saint-Benoît. Mais en 1358, des pillards vinrent ruiner ce petit paradis et les religieuses migrèrent vers Valréas où elles reçurent l’autorisation de s’installer.
A partir de ce moment le Prieuré était voué à disparaître. Les bâtiments furent détruits sans que l’on sache vraiment à quelle époque cela se passa et seule subsiste de nos jours la carcasse de l’église prieurale dont nombre de pierres servirent aux autochtones pour construire la chapelle paroissiale. Pratique courante ! Après tout, les grands monuments romains ne furent-ils pas des carrières pour leurs voisins jusqu’à ce que Prosper Mérimée, ministre de la Culture de Napoléon III, ne comprenne qu’il fallait défendre ces patrimoines.
Vue aérienne que l’on doit à Google Maps.
Les voisins du Prieuré avaient aussi compris que ces sources qui coulaient en abondance dans l’église, certains parlent de deux, d’autres de sept comme les sept piliers de l’église, ces sources pouvaient les soigner de maux divers. On dit qu’elles guérissaient la tête, qu’elles soignaient les problèmes des yeux de ceux de la peau. Alors, longtemps des Pèlerinages se déroulèrent et ils attiraient beaucoup de pèlerins. Mais pas seulement que des croyants ! Des bandits de grand chemin, eux, préféraient les espèces sonnantes et trébuchantes des bourses des visiteurs à la pureté supposée des eaux miraculeuses. Si bien que peu à peu, sans voisins vigilants, cette insécurité fit fuir les pèlerins et les Pèlerinage disparut. Si un miracle survient chez un marcheur d’ACP qui aura goûté l’eau qui continue de couler dans les ruines de l’église, si ça marche pour les oreilles par exemple, notre Président ne manquera pas de proposer la relance de cette manifestation festive… qui pourrait alors aider au financement de la rénovation de la « Chapelle du cimetière » ! Hé ! Hé!
Quant aux brigands, ils prirent une autre forme, raconte Roland Brolles….
…dans son livre « Dans l’ombre des soutanes » paru en mars 2003. Peu avant la Révolution, arriva au village un curé nommé Jean Joseph Reymond, originaire du Comtat Venaissin. Il visitait les paroissiens, les confessait, leur tirait les vers du nez avant de leur soutirer leurs magots de famille et autres économies à l’aide de quelques comparses. Un curé ripoux en somme ! Irréprochable vis à vis de l’Etat, il avait même prêté serment à la Constitution civile du Clergé. Le meilleur moyen d’être tranquille de ce côté-là ! Par contre, un différent avec un ancien acolyte, un certain Joseph Pancrace Jardin, se termina par un coup de kalachnikov pistolet qui mit fin à l’équipée de Reymond en même temps qu’à sa vie. Longtemps on raconta dans les veillées à La Bégude ou à Taulignan, les méfaits du curé d’Aleyrac puis on oublia, une nouvelle horreur chassant l’autre.
Il ne manquait plus qu’à quelques agents voyers du département (les ingénieurs de la DDE) de prélever de nouvelles pierres de l’église prieurale au début du XXème siècle pour arranger et restaurer les routes entre Salles et le pays de Mazenc. Le holà fut vite mis par l’Etat qui classa les restes du Prieuré d’Aleyrac monument historique, le 06 mai 1905. Mais sans sou de l’Etat, il fut figé… en l’état.
Reste à venir découvrir ou re-découvrir ces ruines (presque) millénaires le 22 février prochain, avec les marcheurs d’Ancône Culture et Patrimoine.
Première de couverture du livre de Roland Brolles « Dans l’ombre des soutanes » paru en 2003 chez Albanox-Archives et Terroir. Vous y découvrirez 36 autres histoires aussi invraisemblables mais réelles que celle du curé d’Aleyrac…