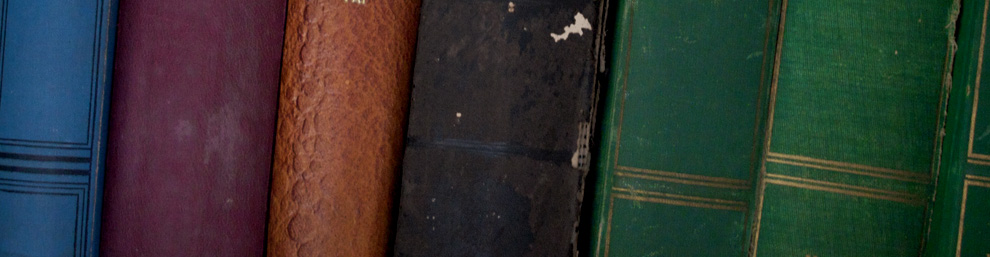Deux revues ce 18 juillet, deux hebdos, l’un sportif:

Le Miroir des Sports, tri-hebdomadaire pendant la Grande Boucle, et…
l’autre généraliste…

la célébrissime L’Illustration, qui en 1936 est déjà une vieille dame de 94 ans, un tantinet ringarde !
Le Miroir des Sports conte à ses lecteurs les étapes Grenoble-Briançon et Briançon-Digne dont on a déjà parlé.
En couverture (ci-dessus) Antonin Magne signe des autographes à ses supporters, lui qui est devenu « le rempart du cyclisme français » dans ce Tour 36 et qui « ne désespère pas de gagner pour la troisième fois la grandiose épreuve ».
On nous le montre en champion au sommet d’Allos…

où il mit en difficulté le leader belge Sylvère Maes.
Un Maes abandonné à son sort par son coéquipier et homonyme Romain Maes, le vainqueur du Tour 1935 qui abandonna la course du côté de Plan-Lachat au pied du Galibier et alla se rafraîchir les muscles dans un torrent voisin aux eaux glacées.

Tout le contraire des frères luxembourgeois Clemens…

qui s’épaulent dans la difficulté. A noter que Romain et Sylvère Maes n’étaient pas frères ni cousins.
Bien entendu, la défaillance de Maurice Archambaud sur la route de Briançon est détaillée…

et le coursier français trouva en Cogan un soutien appréciable.

Pas de Tour de France dans L’Illustration, peu de 14 juillet non plus, si ce n’est la manifestation des forces de gauche soutenant le gouvernement de Front Populaire de Léon Blum.

Une foule impressionnante à Nation et à la tribune, les leaders…

De gauche à droite: Léon Blum, Maurice Thorez, Roger Salengro, Maurice Viollette et Pierre Cot. Un Roger Salengro, au centre, bien sérieux et peu souriant. Il faut dire qu’il était victime de calomnies de la part d’une partie de la droite et de l’extrême-droite le traitant de déserteur en 1915 alors qu’il avait été tout simplement fait prisonnier. La campagne sera d’une telle violence que Roger Salengro finira par se suicider le 17 novembre 1936.
Autre sujet mais plus conséquent dans cette Illustration, Verdun et les célébrations du vingtième anniversaire de la bataille.

Le 14 juillet en 1936, le 28 mai en 2016… pourquoi ces dates et non pas le 21 février, premier jour de l’attaque allemande. Peut-être parce qu’en février, le climat est bien trop froid ! Pas de jeunesse courant vers l’ossuaire qui aurait fait s’étrangler les plus ringards comme en 2016, mais les encore jeunes anciens combattants…

retrouvant leurs 20 ans dans ce camp monté sur l’hippodrome,

ou allant chercher le jus à la cantine mobile, comme en 16.

Et bien sûr le recueillement devant l’ossuaire, au milieu des tombes….

pour prêter le Serment de la Paix qui sera, lui, méchamment piétiné, 3 ans plus tard !
Mais ce qui se trouve être le plus intéressant, c’est la narration illustrée de ce voyage en Espagne, en Andalousie, à la rencontre d’un pays marqué depuis plusieurs semaines par la multiplication des actes violents qui suivirent l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement de Front Populaire, comme en France.
Il y a bien sûr des clichés touristiques comme ce panorama depuis l’Alhambra de Granada

la foule animant les rues pour la Foire

et les champs d’olivier appartenant à de grands propriétaires terriens.

Mais il y a aussi ces terribles statistiques montrant les actes violents commis ici et là du 16 février au 15 juin et le leader de droite Gil Roblès dénonça aux Cortès.

A Grenade, les traces de l’émeute du 10 mars causés par la révolte des paysans misérables sont visibles partout.

Façade de la Chocolaterie Saint-Antoine incendiée.

Eglise Saint-Sauveur et immeuble du journal conservateur Idéal.

Le logement du sacristain.

Le siège de la Phalange.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le journaliste Paul-Emile Cadilhac est loin d’être critique pour les émeutiers. Les conditions de vie de l’immense sous-prolétariat agricole sont telles que l’auteur comprend ces coups de colère collectifs. Nombre de paysans ne savent pas ce qu’ils vont pouvoir manger et donner à leurs enfants quand ils se lèvent le matin. Et la réforme agraire commencée par le gouvernement de Madrid semble logique pour l’auteur de l’article tant l’injustice est flagrante. D’où ces slogans communistes:

Voter pour un candidat communiste, c’est voter pour un gouvernement ouvrier et paysan.
Le voyage se continue dans les Asturies qui connurent un excès de fièvre en 1934. La révolte des mineurs entraîna ici les mêmes destructions et la République envoya alors Franco pour rétablir le calme.
Dans le nord de l’Espagne, comme dans le sud, ce sont les églises qui ont fait les frais de la colère populaire.

A Ferreros près d’Oviedo.

A Tellego, l’église Saint-Nicolas où un chef-d’oeuvre de Titien fut détruit dans l’incendie.

Le palais épiscopal d’Oviedo vu de la cathédrale après l’émeute de 1934.
Et cette violence n’allait pas s’arrêter, car, alors que la presse ne sait encore rien, la veille, le 17 juillet 1936, les militaires ont tenté de renverser la République et que, sans que personne ne s’en doute, la guerre civile vient de commencer. On verra cela demain !