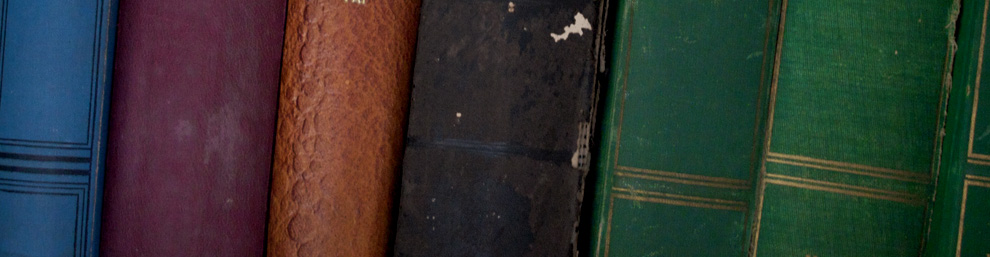Jusqu’à il y a une vingtaine d’années, ce toueur était entreposé dans les chantiers fluviaux de la Coucourde, au nord de Montélimar. Puis, on le déplaça dans le port de la capitale (de la Drôme), sûr qu’il allait être restauré et mis en valeur et qu’il deviendrait la pièce emblématique d’un futur hypothétique musée de la batellerie du Rhône. Raté ! Les crédits espérés ne vinrent jamais et voilà le fier bateau, mis à l’écart, abandonné au bord de l’eau, devenant peu à peu un tas de ferraille rouillée, tagué de dessins d’aucune valeur, au sud du port de l’Epervière, à demi-immergé dans les eaux irrespectueuses du fleuve. Les joggeurs, promeneurs avancent sur la digue, juste à côté sans même le voir et ce n’est pas le panneau explicatif que plus personne ne regarde qui va raviver l’intérêt du passant pour cet ancien maître du Rhône. Qui aurait envie de visiter une casse automobile ? Sans compter le danger que peut représenter une épave dans cette position si l’on s’en rapproche trop… Quel gâchis !

Sur le panneau en question, on nous le présente ainsi, tel qu’il avait été photographié il y a plus d’un siècle, pour les besoins d’une carte postale, au port du Pouzin. Voilà ce qu’il est devenu avec en toile de fond, le nouveau pont des Lônes sous lequel il n’est jamais passé dans sa jeunesse.

Comme on peut le lire,

8 toueurs (9 au début en 1896) se partageaient le passage le plus pentu du Rhône de Glun à Pont-Saint-Esprit, par tranches de 12 à 15 km. 8 ports d’attache et 8 secteurs sur lesquels les joueurs se relayaient pour remonter 2 barques chargées de 300 tonnes de marchandises.

8 étapes à la remonte: Pont-Saint-Esprit- Bourg-Saint-Andéol; Bourg-Saint-Andéol- Viviers; Viviers- Le Teil; Le Teil- Cruas; Cruas- Le Pouzin; Le Pouzin- Etoile-Chamfort; Etoile-Chamfort- Valence; Valence- Glun. A chaque étape, il fallait donc détacher les barques du toueur arrivant du sud pour les rattacher au toueur descendant du nord… et ainsi de suite. Comme ici le passage de relais à Bourg-Saint-Andéol (1)..

Certainement un peu fastidieux ! A la descente, les barques étaient attachées de part et d’autre du toueur pour éviter qu’elles ne poussent celui-ci, étant plus lourdes que lui. (1).

Celui de l’Epervière a d’ailleurs gardé ses câbles d’attache des barques, presque encore enroulés sur leur treuil…

ainsi que les guides vers le cul aval du bateau (pas une grossièreté, on appelait aussi les toueurs « bateaux à 2 culs »!)

Décomposons un peu cette antiquité à partir de cette vue latérale:

L’avant…

d’où le cable fixé au port en amont, sortait de l’eau et venait coulisser sur des poulies et guides qui le conduisait jusqu’au grand tambour sur lequel il s’enroulait. On en reparlera.

Voici donc le dessus de la salle…

dans laquelle se trouve le grand tambour sur lequel le câble venait s’enrouler. En s’approchant, on constate que câble comme tambour sont encore bien présents…


baignant dans l’eau du fleuve qui est entrée dans tout le bateau. Quelle tristesse ! Ce tambour fait tout de même 1,50 mètre de diamètre et 3,50 mètres de largeur ! C’est la pièce essentielle du bateau puisque c’est ce tambour qui en tournant fait avancer le bateau qui remonte le fleuve. D’autres vues de cette salle du tambour:


A l’arrière de celle-ci, presque au dessus, la passerelle sur laquelle se trouvait le capitaine qui conduisait le bateau:

On y accédait par un escalier dont les marches ont disparu.



Il ne reste plus que la carcasse de cette cabine de pilotage, les côtés comme le toit, en matériau périssable (du bois et de la toile) ayant disparu. On peut le constater ci-dessous sur cette vue d’un toueur à l’arrêt au port de Viviers, en face du défilé de Donzère (1).

Continuons notre descente du bateau avec la salle des machines dans laquelle se trouvait un moteur de 200 CV…

surmontée de la cheminée par laquelle sortaient les fumées.

Une cheminée dont on remarque en bas l’articulation qui lui permettait de se plier quand le bateau passait sous les ponts.

On peut le constater sur cette vue ancienne d’un toueur arrêté au port de Montélimar, après qu’il soit passé sous le pont du Teil, la hauteur d’eau étant assez importante à cet endroit (1).

Une salle des machines elle-aussi envahie par les eaux du Rhône.

Les aérations sont toujours là…


avec leur gueule semblant hurler toute la détresse de leur situation.

Nous sommes quasiment à l’extrémité du bateau, reste l’arrière dont on a déjà parlé où étaient attachées les barques remplies de marchandises.

Le Rhône ne fut pas le seul fleuve à connaître les toueurs comme on peut le lire sur ce panneau explicatif.

Mais seuls les mariniers du Rhône devaient veiller à ce que le cable ne passe la nuit dans l’eau sous peine d’être recouvert par les graviers que chassait régulièrement le fleuve. Ainsi le toueur devait obligatoirement rejoindre son port d’attache (c’est le cas de le dire !) avec le cable enroulé au tambour.

Toueur à l’arrêt au port de Montélimar (1).
Les mariniers de la Seine ou de la Loire ne connaissaient pas ce problème.
Il existe un dernier toueur en activité dans le tunnel de Riqueval dans l’Aisne. Il est utilisé pour tirer les péniches dans ce tunnel non ventilé. Il est lui-même mû par l’électricité ce qui évite émanations et intoxications. Sur le Rhône, le touage a disparu au moment où les péniches, automoteurs ou autres remorqueurs à roue à aubes furent assez puissants pour remonter le Rhône dans ce secteur le plus pentu, un dénivelé de 70 mètres entre Glun et Pont-Saint-Esprit. C’était en 1936.

Le château de Crussol qui domine le Rhône en face de Valence
et veille sur les derniers jours du dernier toueur du fleuve.


La seule inscription moderne digne d’intérêt !

Une barque que l’on pouvait guider et son toueur au fond, au port de Montélimar (1).
(1) les cartes postales font partie de la collection de Marc Durand qui nous les a prêtées pour illustrer cet article . Qu’il en soit remercié !