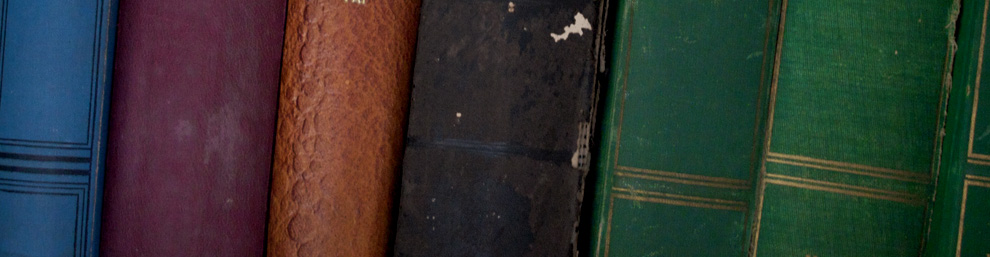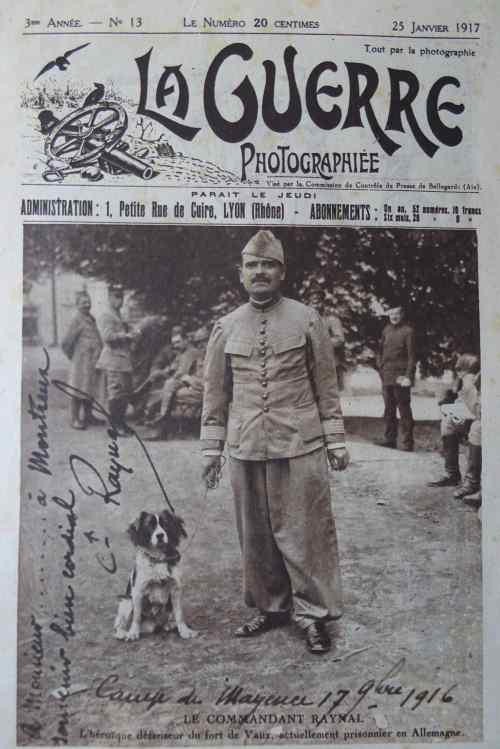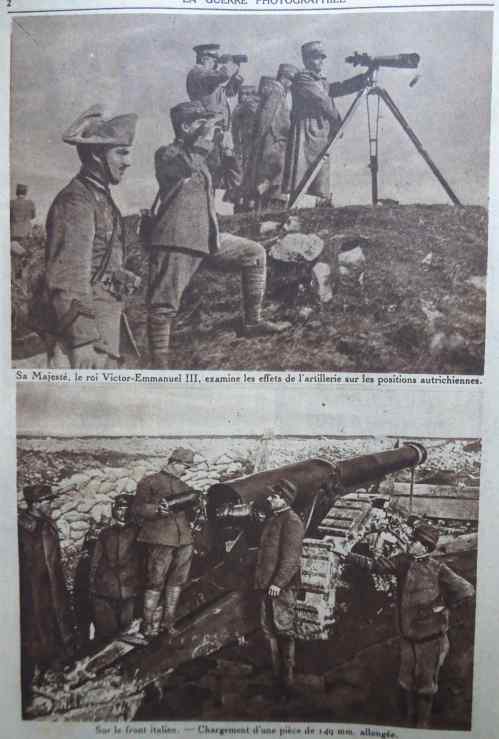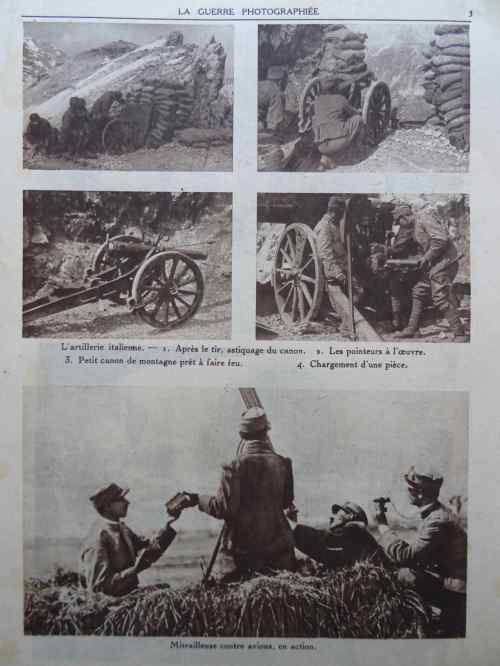Cela ne date pas d’hier, ni d’avant hier. Mais de 1827. C’était alors la fin de l’été 1827 et, depuis le château de Saint-Cloud, lieu de villégiature du roi à la Restauration, Charles X décida par ordonnance qu’il autorisait la construction d’un pont à Valence. Un pont suspendu bien entendu, puisque 2 ans auparavant les frères Seguin avait jeté la première passerelle en fil de fer sur le Rhône à Tournon. Une passerelle qui devait être doublée quelques années plus tard d’un pont plus large qui existe toujours alors qu’au début des années 1960, le premier pont suspendu du Rhône allait être détruit par la CNR.

Voici donc le début de cette ordonnance, le passage important étant l’article 1er que voilà:

C’est donc le sieur Barrès de Mollard qui reçoit l’autorisation de construire le pont et de percevoir le péage dont une partie se retrouvera dans les caisses royales. Ce droit est concédé pour 66 ans ce qui devrait largement amortir les frais de construction qui s’élèveront tout de même à 600 000 francs, réparations du pont au début comprises, on y reviendra.
Mais ce qui est le plus amusant à lire est le détail de ces frais de péage. Il ne tient pas moins de 2 pages du Bulletin des Lois et chaque cas particulier est prévu. On est loin du tarif unique !




Cela va de 5 centimes pour un piéton jusqu’à 3 francs pour un semi-remorque de l’époque à savoir un chariot de roulage à quatre roues, chargé, tiré par 3 chevaux + le conducteur.

la patache de Vernoux
Mais il existe tout de même quelque gratuité pour des ayant-droits: le préfet, le sous-préfet, les ingénieurs des ponts et chaussées, la gendarmerie, les militaires voyageant à pied ou à cheval, en corps ou séparément, à charge à condition alors de montrer un ordre de mission, les courriers du Gouvernement et les malles poste.

Quelques mots sur la suite. Les travaux de construction de ce pont commencèrent en juillet 1829. Les travaux allèrent assez vite puisque le 18 septembre 1830 le pont suspendu des Granges fut mis en charge avec bonheur et ouvrit à la circulation (et aux droits de péage !) le 24 septembre suivant.
C’est la suite qui fut plus difficile. Le bac à traille fut obligé de fermer ce qui aboutit à quelques jalousies et rancoeurs, faillites aussi. Alors, sans qu’on sache vraiment pourquoi, le tablier du nouveau pont brûla en plusieurs occasions, les fermetures pour réparations entraînant… la réouverture du bac. Puis ce fut la crue de 1840 qui détruisit la pile de la rive droite (côté Granges)… la crue de 1856 qui mit à bas l’autre pile, celle de la rive gauche (côté Valence). Le bac ne fut vraiment pas tout fait au chômage !
L’Etat racheta le péage en avance le 16 décembre 1884 alors que la concession courait jusqu’en 1896. Il faut dire que les usagers protestaient de plus en plus et pétitionnaient pour des tarifs abusifs. Ce n’est pas en 2016 que les politiques écouteraient les usagers des autoroutes devant les tarifs prohibitifs de ces voies de communication qu’ils ont payé avec leurs impôts !
Enfin, à la fin du XIXème siècle, les autorités locales souhaitèrent qu’un train, un tramway, passe sur le pont pour joindre l’Ardèche à la gare de Valence. Ce ne pouvait être sur le vieux pont suspendu qui n’aurait résisté à la charge. On construisit donc au début du XXème siècle, un pont de pierre qui doubla le pont ancien, lequel ouvrage d’art fut détruit vers 1910. Il aura vécu et servi 80 ans tout de même.
Dommage, il avait plus de cachet que le pont Mistral actuel !!! Ces quelques CPA datant de la bascule XIXème-XXème siècles nous donne une idée de ces franchissements du Rhône au niveau de Valence.

vue prise en Ardèche en aval du pont

entré du pont côté Drôme

les bains publics sous le pont des Granges

les deux ponts cohabitèrent quelques années

le nouveau pont de pierre

sur le nouveau pont de pierre

l’ancienne culée du pont suspendu, rive droite.