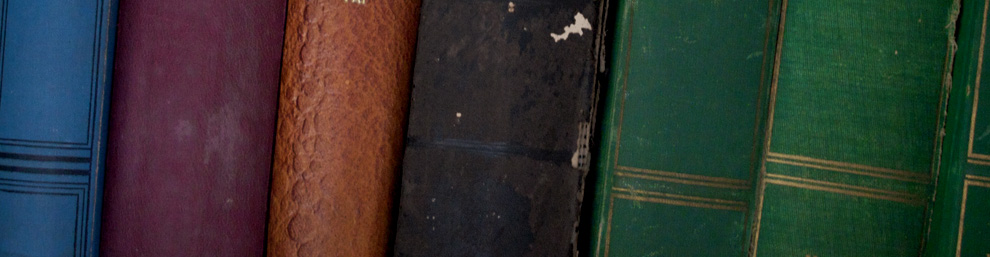Paul Marquion était un des responsables du Bulletin des Amis d’Orange dans les années 60-70. Il écrivait régulièrement dans ce mensuel. Il décida de raconter la vie au temps jadis dans les villages du Vaucluse. Originaire de Caderousse (et copain de mon grand-père Gabriel- voir article sur la borne seigneuriale), le village était tout trouvé et les chroniques racontées n’étaient autres que les souvenirs d’enfance et de jeunesse de l’auteur.
Première chronique: le pèlerinage annuel à Notre-Dame de Rochefort, dans le Gard, à une quinzaine de kilomètres de Caderousse. Une histoire que je connais un tout petit peu, ma grand-mère Philine Boissel, l’épouse de Gabriel, ayant souvent parlé de ce moment agréable, une sortie très attendue, plus par tous les à-côtés que pour son caractère religieux, me semblait-il.

Voici quelques extraits de la narration de Paul Marquion.
Avant la guerre de 14, le pèlerinage à Notre-Dame de Rochefort était l’un des rares grands événements de l’année qui, avec la foire d’Orange et le conseil de révision, mettait tant branle le village et le sortait en foule hors des murs.
Ce jour-là, les deux diligences de Caderousse qui assuraient le service des voyageurs et des messageries avec Orange et, une fois par semaine, avec Avignon, étaient retenues pour le pèlerinage. La plus grande pouvait bien transporter une vingtaine de personnes : huit dans le coupé et douze dans l’impériale. La plus petite pouvait en transporter une quinzaine. Le coupé été réservé aux personnes âgées qui n’étaient pas trop sensibles au manque d’air et au renfermé et la jeunesse prenait place à l’impériale. Ce n’était d’ailleurs pas le seul moyen de locomotion employé : des diligences étaient utilisées par les habitants intra-muros du village. Les paysans de la campagne s’y rendaient en jardinière et même, plus anciennement, en charrette. Les routes à l’époque n’étaient pas goudronnées : il y avait des ornières et des nids-de-poule, les charrettes n’avaient pas de ressorts. Mais les chaos et des secousses qui résultaient n’enlevaient rien de la belle humeur de ces jeunes filles pas plus d’ailleurs que la longueur d’un voyage accompli dans de telles conditions d’inconfort. De Caderousse à Rochefort, il faut compter une vingtaine de kilomètres, ce qui représentait deux bonnes heures de route.
Et le grand jour arrivait. De très bonne heure, les pèlerins chargés de bagages (paniers à provisions, vêtements) affluaient à la maison de Lengado (c’était le nom du voiturier) et commençaient à prendre place sur les diligences, qui à l’intérieur, qui à l’impériale, ce qui n’allait pas sans discussions, interpellations et rires. Enfin le voiturier prenait place sur son siège et faisait claquer son fouet en proférant un sonore « Toupin d’estièu », car, un jour de pèlerinage, avec une voiture pleine de dévôts, il eût été malséant de lancer le juron de rigueur auquel les chevaux étaient accoutumés. L’aube commençait à peine à poindre quand les diligences franchissaient le portail de Place et preneaient la route du Lampourdier. Le voyage commençait mais on était encore sur le territoire de la commune : le paysage était connu et la surprise ne commençait qu’en arrivant à la montagne. Car pour les Caderoussiers, les collines du lampourdier, c’était la montagne. Comme la route était jusque-là uniformément plate, le voiturier faisait « courir », un ayant soin de prévenir les pèlerins pour leur éviter les surprises d’un changement d’allure. Premier épisode : l’arrivée au Lampourdier, le pont sur la Meyne que l’on appelle à Caderousse le pont de la Roubine et la cascade du canal de Pierrelatte. On en parlait depuis le départ : coulera ? coulera pas ? Joie déception suivant le cas. On longeait ensuite la colline, on passait devant le château du Lampourdier où nul Caderoussier n’ avait jamais pénétré et qui s’enveloppait d’un voile de mystère. Puis la route quittait le Lampourdier et se dirigeait en droite ligne vers le pont de Roquemaure. Du village de Caderousse au Lampourdier, sur une longueur de 3 km, la route ne compte pas moins de 28 détours dont certains à angle droit. Aussi, pour un Caderoussier, cette route toute droite qui va du Lampourdier au pont de Roquemaure était un sujet d’étonnement. Au bout de la route, c’était le pont suspendu de Roquemaure, à plusieurs arches, détruit pendant la dernière guerre et qui a été remplacé par un pont magnifique qui franchit le Rhône d’une seule enjambée. La traversée du Rhône était un des moments solennels et émouvants du pèlerinage. Le vieux pont suspendu était étroit ; les sabots des chevaux faisaient résonner désagréablement les planches du tablier et du haut de l’impériale le fleuve paraissait profond. Disons-le sans ambages : nous n’étions pas tellement fiers ! On respirait quand on arrivait à une pile ; pendant quelques mètres où on se retrouvait sur le dur et où le Rhône était masqué. Mais on n’était vraiment rassuré qu’en arrivant à la dernière. Alors on recommençait à faire les braves, le sourire apparaissait sur les lèvres. Mais disons la vérité, on avait eu peur. Et si les chevaux s’emballaient ! Et si la diligence versait ! Tout autant d’éventualités peu réjouissantes. De loin on avait salué le château de Montfaucon et, après un assez long parcours en plat et en ligne droite où le voiturier avait de nouveau « fait courir », on arrivait aux falaises de Roquemaure, autrement impressionnantes que les collines du Lampourdier. Nouvelle terreur : et si ces falaises à pic venaient à s’effondrer et à écrabouiller nos voitures ! Aussi était-on soulagé d’arriver aux portes de Roquemaure. Sur tout le trajet entre Caderousse et Roquemaure, c’est le seul village traversé : il s’agissait donc de produire une grosse impression sur les habitants, on s’y employait de son mieux en les interpellant du haut des voitures – on ne risquait rien – ou plus sagement encore en chantant des cantiques. Après la traversée de recrutement, on passait sous le pont du chemin de fer avec l’espoir qu’un train passerait à ce moment-là et on arrivait ensuite à une petite chapelle qui se trouve en bordure de la route à gauche en allant sur Rochefort . Dieu sait si on l’attendait cette chapelle ! Depuis longtemps les jeunes filles avaient préparé leur gros sou. Car cette chapelle avait, si elle ne l’a plus, sa réputation. Elle ne s’ouvrait sur la route par une porte pleine et de chaque côté de cette porte se trouvait une fenêtre avec barreaux entrecroisés et passablement rapprochés les uns des autres. Et la croyance voulait que toute jeune fille qui lançait un gros sou du haut de la voiture se marierait dans l’année si le gros sous, adroitement dirigée, pénétrait à l’intérieur de la chapelle par une des fenêtres. Pour la circonstance, le voiturier arrêtait la diligence sur le côté droit de la route en rasant le fossé car il n’avait aucun intérêt à voir les jeunes filles se marier dans l’année et pour cause. La coutume voulait que les gros sous qui avaient manqué le but et étaient tombés hors de la chapelle devenaient sa propriété.
C’est à partir de la chapelle que le voyage prenait toute sa nouveauté. Contrastant avec les routes absolument plates de Caderousse, la route de Rochefort était dès lors une succession de montées et de descentes et le voiturier avait peu d’occasions de faire courir. Les granges devenaient rares, la garrigue tenait plus de place que les cultures. Comparée à l’opulente et verdoyante pleine de Caderousse, la région était une sorte de désert. Et pendant des kilomètres il en était ainsi, ce qui attirait l’apitoiement des pèlerins sur les malheureux habitants d’un pays aussi déshérité. Et on arrivait ainsi à un autre et dernier jalon qu’on appelait la porte des lions, comme à Mycènes. Elle existe encore : il s’agit de l’entrée d’un vaste domaine marquée par de hauts piliers surmontés chacun de lion doré. C’était une curiosité du voyage.
Enfin, après quelques derniers kilomètres, apparaissait ce sanctuaire avec, sur le flanc de la colline, les monumentales stations du Chemin de Croix. Au bas de la montée se trouvait une ferme avec étables où le voiturier dételait et remisait ses chevaux. Pendant quelques instants, chacun s’ébrouait, se dégourdissait les jambes, car en principe le voyage ne comportait pas d’arrêt, et reprenait ses bagages. L’ascension de la côte commençait soit par la route soit par les raccourcis. Le rassemblement avait lieu devant le porche du sanctuaire. Un premier office allait se dérouler : la messe de communion. Car, parmi des pèlerins, un certain nombre allait communier, c’est-à-dire qu’ils étaient rigoureusement à jeun depuis la veille…
A partir de là, Paul Marquion raconte sur 2 pages les diverses cérémonies religieuses de cette journée de pèlerinage: les messes, le chemin de croix, les vêpres… Puis il narre rapidement le retour à Caderousse.
Par le même chemin qu’à l’aller, on regagnait Caderousse après 2 grosses heures de route dont les derniers kilomètres, à partir du Lampourdier, était les plus languissantes. Et la nuit était sur le point de tomber quand les diligences, retentissant du vacarme d’un ultime cantique, abordaient les digues. Tous Caderousse était là, attendant le pèlerinage et ne voulant pas un si rare spectacle. C’était fini, mais on avait des sujets de conversation pendant des semaines entières. Et même si l’on n’avait pas chaque fois un chantre comme celui du Gard à se mettre sous la dent (1), combien d’anecdotes avait-on à raconter et à entendre.
(1) une anecdote narrée plus haut, un concours de chorale qui s’était passé une année et où les chœurs de Caderousse avaient été battus à plate couture, vocalement parlant !