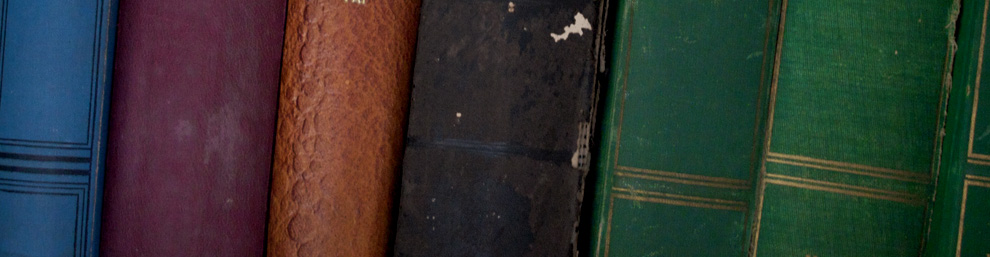Dans ce numéro 44 du bulletin des amis d’Orange,…

Paul Marquion parle de Caderousse dans une série d’articles sur le Bulletin des Amis d’Orange et pour ce numéro 44 du second trimestre 1971 du milieu physique et humain de cette commune du Vaucluse, avant 1914. Il s’agit d’un long article qui sera présenté en 3 fois sur le blog. Tout d’abord une description commentée des lieux.
Le Rhône est évidemment le grand responsable de cet état de choses (que le village ait conservé son aspect ancestral) : quoi que l’on fasse à Caderousse, il a toujours fallu compter avec le Rhône et ce n’est qu’après la construction de la dérivation du fleuve qui mettra le territoire à l’abri des inondations et dont les premiers travaux viennent d’être entrepris que le visage de Caderousse risque d’être entièrement modifié. Or si rien pour le moment n’a bien changé, c’est le Rhône lui-même qui a subi les plus grandes modifications. Avant la guerre de 1914, comme en témoignent les photographies de l’époque, son cours était large et relativement profonde. Plus anciennement, il était navigable. Le chemin de halage qui le bordait, le «caladat », s’il est aujourd’hui enfoui sous l’épaisseur des sables est encore visible en certains points, notamment à proximité du village, en bordure de la digue, où l’on voit encore les anneaux scellés dans la pierre qui servaient à l’amarrage des bateaux. L’accès de l’île de la Piboulette se faisait par un bac à traille, le premier aux abords du village même, l’autre au quartier des cabanes qui restait en service toute l’année. Ce n’est qu’en été, aux très basses eaux, que l’on pouvait traverser à gué (à la gaffe). Aujourd’hui , à Caderousse, le Rhône s’est considérablement rétréci, son lit s’est encombré de gravier et de sable sur lesquels a poussé une végétation exubérante de saules et de peupliers, formant de véritables îlots. Les anciens ne reconnaissent plus le Rhône de jadis.
A noter que les travaux de la CNR de la chute de Caderousse sont en train de commencer quand Paul Marquion écrit cet article. A cette époque, mon grand-père Gabriel se plaisait d’aller voir travailler les scrappers et autres mastodontes construisant les berges du canal mais détruisant l’île de la Piboulette dont Paul Marquion va parler. Il ne verra pas la mise en eau du canal puisqu’il décèdera en 1973.
Dernièrement, la grande île de la Pirouette s’est, elle aussi, profondément modifiée. C’était encore, il n’y a pas bien longtemps, avant tout un terrain de chasse, avec des bois très touffus, parfois impénétrables, où les champignons « de matte » et les cèpes poussaient à profusion et où le gibier, lapins et surtout faisans, pullulaient. Seules quelques fermes, installées au milieu de clairière exploitaient un sol de limon particulièrement fertile. C’était le grand terrain de chasse de Monsieur de Lafarge, qui avait fait bâtir un pavillon appelé le château, avec chapelle attenante où certains dimanches de grande chasse, le curé de Caderousse ou son vicaire venait célébrer la messe. De nos jours, l’île a été en grande partie déboisée et défrichée par les pieds-noirs et les vastes étendues forestières ont fait place à des terrains de culture et de vergers. La construction du canal du Rhône, qui doit traverser l’île du nord au sud par son milieu va de nouveau bouleverser la topographie.
Le village lui-même dans sa ceinture de digues, n’a subi aucune transformation importante. Le goudron a remplacé l’ancien pavage en galets du Rhône de la plupart des rues, solide et même inusable, où l’on se tordait facilement la cheville et où les roues cerclées de fer des charrettes cahotaient avec un beau vacarme. Mais les eaux usées s’écoulent toujours par les rigoles et les lônes et l’ancestrale coutume pour les ménagères de balayer chaque matin la rigole devant leur porte est toujours en usage, faute de tout-à-l’égout. Il n’y a même pas l’eau courante qui est considérée pourtant comme un minimum de confort moderne. Peut-être n’en a-t-on jamais senti l’impérieux besoin dans un pays où la nappe et peu profonde et où il n’y a qu’à creuser n’importe où pour trouver de l’eau. On trouve dans certaines rues des pompes à main publiques, fort anciennes, avec bassin. (J’en ai noté une, rue Vénasque, sur le trajet entre l’EHPAD et la place Jean Jaurès) C’est encore avec une pompe à main que se fait dans chaque maison l’alimentation en eau, à moins que le propriétaire ait fait installer un moteur électrique. Avant la guerre de 1914, les maisons aussi bien dans le village que dans la campagne, n’avaient pas toutes leurs pompes et l’eau était puisée directement dans le puits.
Un certain nombre d’immeubles qui menaçaient ruine ont été rasés, comme ont disparu plus anciennement certaines demeures de notables et co-seigneurs de Caderousse qui, d’après les vestiges qui restent, avait dû être spacieuses et confortables. Peu de constructions nouvelles : en tout cas aucun de ces immeubles modernes, dit « cage à l’appel » qui tendent à devenir le mode d’habitat courant de notre époque. A Caderousse, il n’existe que des maisons individuelles. Il serait pourtant injuste de ne pas signaler un effort récent mais tangible de modernisation de nombreuses vieilles demeures et le ravalement de nombreuses façades, ainsi que le nettoyage de certains quartiers, tel celui dit de Médecin, qui fut longtemps une sorte de dépotoir public et qui ne méritait pas cette disgrâce, car il s’agit d’un cours ombragé de très beaux platanes qui borde l’ancien rempart. On peut dire que le village tend à perdre ce visage terne et vétuste qu’il avait il n’y a pas encore beaucoup d’années.
Rien n’a été modifié au tracé des rues dont la caractéristique commune à toutes les villes et villages de jadis, est d’ignorer la ligne droite. Il convient d’ajouter qu’à Caderousse les rues sont en général relativement larges, même quand il s’agit des rues adjacentes qui aboutissent à l’artère principale qui traverse le village du nord au sud, qui a été baptisé à la fin de la dernière guerre « rue du Docteur Guérin », en souvenir d’un bienfaiteur du village mais qu’on continue à appeler « la grand’ carrière ».
Les noms des rues du quartier n’ont pas changé, à de rares exceptions près et sont tels qu’ils figurent sur les anciens cadastres : nom de saints, Saint-Louis, Saint-Michel, nom dont on devine l’origine ancienne par suite de leur situation ou de leur destination : rue du Fond du Sac, rue Juterie (ou devait être cantonné les Juifs), rue de l’Escurier (qui desservait les anciennes écuries du château), quartier de la Pousterle (voisine une des anciennes poternes du rempart), quartier du Pilori (où se trouvait le pilori). Mais sur le nom d’autres rues et quartiers : rue Pied-Gaillard, rue du Puits des Voûtes, quartier du Boulégon… on se perd en conjoncture. (Je suis sûr que Jean-Paul Masse peut expliquer l’origine de ces noms…)
Enfin il faut noter qu’au pied de la digue et à l’intérieur, là où se trouvaient jadis les remparts et des fossés, se développe, tout autour du village, un vaste espace planté de platanes qui, côté levant est dénommé « le cours », bien dégagé et qui, depuis 1 siècle, est devenu le lieu de toutes les festivités foraines et, côté couchant est dénommé «Lou Barri », en souvenir du rempart et qui sert à tout usage – ce n’est pas peu dire – aux riverains…
Suite de l’article avec une description de la campagne:
Ce qui a peut-être le plus modifié le paysage, c’est la disparition du mûrier, devenu inutile avec la disparition totale de l’élevage des vers à soie qui était jadis très florissant à Caderousse, (300 quintaux de cocons avant la Révolution), qui était encore pratiquée sur une grande échelle avant la guerre de 1914, pour décliner entre les deux guerres et disparaître complètement depuis la dernière. Avant la guerre, le mûrier était roi. La plupart des champs avait leur allée de mûriers qui étendaient leurs vertes et épaisses frondaisons et qu’il formait sous le nom de «pourreto » des haies en bordure des chemins. Ils ont presque tous été arrachés, car non seulement ils n’avaient plus d’utilité, mais constituaient avec la traction mécanique, une gêne pour l’exploitation des terres. Le paysage, de ce fait, est beaucoup plus dépouillé que jadis. (Tout a fait exact, il reste dans le grenier familial des clayettes et une couveuse destinées à l’éducation des vers à soie. A quand une expo -si cela n’a pas été fait- sur la sériciculture ?)
Indépendamment du mûrier, d’autres arbres, d’essences méditerranéennes, tendent à disparaître ou ont complètement disparu. À Caderousse, on cultivait jadis, avant la Révolution, le figuier, incomparablement plus abondant que de nos jours et qui donnait lieu à un important commerce : cette culture est aujourd’hui abandonnée et le figuier ne se retrouve que dans les cours des granges et des maisons. Avant la guerre de 14, on voyait de nombreux grenadiers et jujubiers dont les fruits étaient vendus dans les épiceries ou même simplement pillés par les gosses qui s’en régalaient. Les enfants d’aujourd’hui ont d’autres friandises à se mettre sous la dent, que des jujubes (ginjouris) ou des grenades (miougran) et ne s’aviseraient pas, comme le faisaient les enfants de notre âge à se barbouiller le visage en suçant la pulpe douceâtre de la cosse du caroubier (carobi). L’écarlate floraison du grenadier a disparu du décor ; rares sont les jujubiers ; disparus complètement les caroubiers. Le cognassier poussait en général sous forme de haies en bordure des chemins, comme d’ailleurs le néflier et le prunellier et c’était là une sorte de domaine public que chacun, et notamment les enfants, mettaient au pillage. Et le coing était utilisé de différentes façons, depuis le pan-coudoun jusqu’à la délicieuse boisson du coudoyant dont on a perdu le goût, en passant par la gelée, la patte et la confiture de coing….
à suivre…