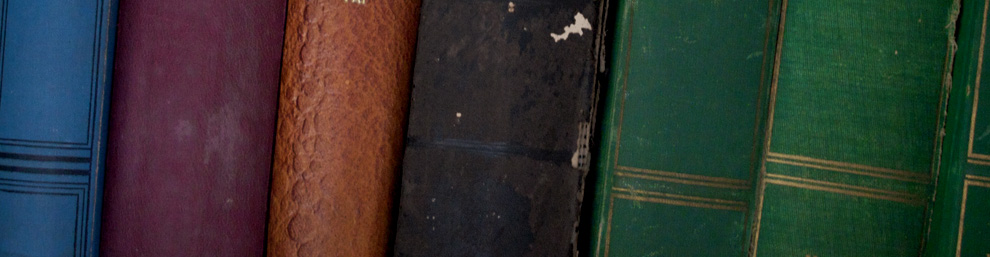Article écrit pour le blog anconecultureetpatrimoineleblog.wordpress.com après des recherches sur l’Etat-civil de la commune mis en ligne par les Archives départementales de la Drôme et cette découverte fortuite qui a marqué la vie de notre commune rhodanienne.
Emmanuel Mallet et Gabriel Marius David étaient des copains de classe à l’école d’Ancone avec François Régis Faucher comme maître au début de leur scolarité, jusqu’en 1881, puis sous l’autorité de Charles Louis Arnaud en fin de scolarité. De jeunes enseignants tous deux qui allaient connaître l’arrivée de l’école à Jules Ferry. Par contre, ni Emmanuel, ni Gabriel n’allaient fréquenter la nouvelle école du village inaugurée l’année où ils cessèrent leurs études, en 1886. Emmanuel et Gabriel étaient aussi des copains de la Classe au sens militaire du terme, la Classe 92 puisque nés tous deux en 72. Emmanuel en juillet, Gabriel, le plus jeune, était venu au monde le 30 novembre 1872.
Gabriel avait vu le jour du côté de Châteauneuf-du-Rhône où son père était fermier. Ses parents s’étaient mariés quelques années avant, à Ancone le 21 août 1866. Son père Raimond Auguste David était cultivateur, né à Savasse en 1835. Sa mère, Marie Brun, était une fille d’Ancone où son père, bien connu, exerçait la profession de maçon. Des enquêtes disent qu’elle était repasseuse, d’autres, femme au foyer. Elle était bien plus jeune que son mari puisque seulement âgée de 19 ans le jour des noces. Elle eut rapidement un premier enfant, Auguste André Gabriel né le 30 mai 1867 qui décéda un mois 1/2 plus tard, mi-juillet comme 5 autres bébés anconnais entre le 30 décembre 1866 et juillet 1867. Terrible année ! Epidémie ou malnutrition ? Puis vint une fille Augustine Gabriel deux ans plus tard qui ne vécut que 5 mois. Gabriel eut plus de chance, en 1872 et fut le premier enfant du couple David à vivre jusqu’à l’âge adulte. Dure époque !
Très rapidement, Gabriel vint vivre chez ses grands-parents maternels à Ancone, le temps que ses parents puissent acheter quelques terres dans la commune ou à Savasse. Puis toute la famille se reforma avant 1880 pour s’installer sous le toit d’une maison de la rue Bachasserie quelquefois appelée rue du Milieu, de son nom moderne. Grands-parents Brun, les parents David, enfants et même la tante Françoise, une soeur de la mère, couturière de son état, vivaient à la même porte. Il était courant à l’époque que les générations coexistent ainsi sous le même toit: les anciens élevaient les plus jeunes et les jeunes s’occupaient des anciens quand ils devenaient trop âgés. Autre époque!
Comme son copain Emmanuel, Gabriel ou Marius comme on l’appelait aussi (une autre chose courante alors que celle d’appeler les gens du second ou de troisième prénom pour rendre bien souvent hommage à un aîné disparu- question de poser quelques problèmes aux généalogistes actuels lors de leurs recherches…) Emmanuel et Gabriel-Marius, donc, furent tirés au sort pour effectuer leurs 3 ans de service militaire, Gabriel avec le n°90 encore une fois juste derrière Emmanuel et son n°86 ! Il fut donc incorporé le 14 novembre 1893. C’est là que les parcours des 2 copains divergèrent légèrement avant de reprendre des destins parallèles !
En gare de Montélimar, si Emmanuel s’était arrêté sur le premier quai pour monter dans le PLM pour le sud, Avignon et les pontonniers, Gabriel dut se rendre sur le quai d’en face pour prendre le PLM en direction du nord, Valence et les artilleurs. Dans la préfecture de la Drôme, tout le monde connaît le quartier du Polygone et la caserne Latour-Dubourg. Polygone d’artillerie, bien entendu, où le 6ème Régiment d’artillerie faisaient ses manoeuvres et les réglages des tirs. C’était donc le 14 novembre 1893 que Gabriel Marius David y débarqua. De 2ème Canonnier à son arrivée, il passa 2ème Servant à cheval le 30 mars 1894 puis 2ème Bourrelier le 20 juin 1894 et enfin 1er Bourrelier le 21 décembre 1894. Pas de véritables promotions mais la reconnaissance de ses connaissances antérieures par l’armée pour l’employer où il était le plus compétant… comme bourrelier. Il fallait fabriquer et réparer sans arrêt les lanières des attelages et c’est le métier qu’il avait appris chez un voisin dans la rue Bachasserie à Ancone.
Le 1er mars 1895, il fut muté au 38ème Régiment d’Artillerie à Nîmes en conservant le grade qu’il avait à Valence. Deux batteries de ce régiment étaient sur le qui-vive depuis que le gouvernement avait décidé d’intervenir militairement en territoire extérieur: à Madagascar. Et un bourrelier qualifié manquait pour l’une d’elle.
Il est bon ici de faire une parenthèse pour expliquer le pourquoi de cette destination originale. On sait que Jules Ferry et nombre de Républicains étaient d’ardents défenseurs de l’agrandissement de l’Empire. Pour faire oublier aux Français les pertes de l’Alsace et de la Lorraine en 1871, ces dirigeants de la Troisième République avaient décidé de se lancer dans ces expéditions coloniales, véritables aventures pour les militaires qu’ils envoyaient: en Indochine où partit Emmanuel Mallet et à Madagascar où ira Gabriel David. A la différence de l’Indochine, c’est vraiment la Troisième République qui initia cette conquête de Madagascar, un territoire aussi grand que la France, une grande île au milieu de l’Océan Indien. Une première expédition pour établir un protectorat avait eut lieu de 1881 à 1883, un protectorat instauré mais pas vraiment appliqué par les Français ni respecté par les autochtones, un royaume dirigé par des reines. Mais des Français étaient allés s’installer là-bas, attirés par l’appât du gain, de l’or qu’on disait être en abondance, par l’inconnu et la nouveauté. Mais quand les massacres d’Européens initiés par les Hovas, une peuplade plus belliqueuse, furent trop importants, une seconde expédition militaire devint obligatoire en 1895 dans le but de « pacifier » une seconde fois le territoire. On y envoya un Corps Expéditionnaire de 15 500 hommes accompagnés de 7 000 convoyeurs, des Kabyles peu respectueux de leurs bêtes de somme. On y trouvait des Chasseurs à pied, des Tirailleurs algériens, un bataillon de marche de la Légion étrangère, des Marsouins, des troupes coloniales, supplétifs Malgaches, Soudanais et Réunionnais, des unités du train, 4 batteries de l’artillerie alpine et 2 batteries montées, celles de Gabriel David et du 38ème R.A. de Nîmes. Pour transporter le matériel à travers le pays, on avait fait construire 5 000 voitures Lefebvre tirées par autant de mulets…. en oubliant un peu vite que sur ce territoire, il n’y avait pas le moindre kilomètre de route ou de chemin ! Que des pistes muletières ! Tracer des routes fut le principal travail des unités du train qui se tuèrent à la tâche, au sens premier du terme !
Les Français débarquèrent donc à Mayunga, sur la côte ouest de l’île, le 23 avril 1895 après un beau voyage où ils franchirent le flambant neuf canal de Suez. Quelle aventure pour l’Anconnais Gabriel David qui figurait parmi eux ! L’objectif des Français: la prise de Tananarive, la capitale du Royaume, au milieu de l’île, distante de 450 kilomètres environ de Mayunga. Ils y parvinrent le 30 septembre 1895 mais à quel prix !!!
On connaît bien les détails quotidiens de cette expédition coloniale grâce aux écrits qu’en fit un soldat, l’Alsacien Léon Silberman engagé dans la Légion étrangère. N’oublions pas que l’Alsace ne faisait plus partie du territoire national en 1895. Ce témoignage est édifiant et consultable dans son intégralité sur la toile. C’est une narration sans complaisance et d’une redoutable précision sur l’impréparation et l’amateurisme de cette expédition, sur l’immense gâchis humain que furent ces 5 mois dans l’Océan Indien. Les chiffres officiels connus de nos jours en attestent: les combats contre les troupes locales, les Hovas, coûtèrent 25 morts au Corps Expéditionnaire Français, presque anecdotique 20 ans avant les hécatombes de la Grande Guerre ! Pourtant celui-ci fut décimé et on dénombra 5 756 morts causées par les maladies tropicales qui assaillirent les hommes. Malgré le dévouement des services de santé, les hommes mourraient par centaines chaque jour, dans les ambulances et les hôpitaux de campagne. Comble d’incompétence, la quinine, indispensable au traitement du paludisme se trouvait au plus bas dans les cales des bateaux, dans des voitures qui ne sortirent qu’à la fin du débarquement et ne parvinrent aux avant-postes de secours que plusieurs mois après le début de l’opération !
Une phrase du récit de Léon Silbermann m’a interpelé. Le légionnaire raconte sa visite faite à une ambulance, un poste de secours avancé. Je regardais un artilleur qui venait de recevoir les derniers sacrements; l’énergie était présente sur sa physionomie; il sursauta à quelques reprises, comme s’il voulait se défendre contre la mort. Etait-ce les derniers instants de Gabriel David ? On apprend en effet sur sa fiche matricule comme sur l’acte de décès recopié par Louis Salomon, le maire d’Ancone sur le registre de l’Etat-civil que « Marius » décéda le 11 août 1895, à l’ambulance de Beritzoka, un piton rocheux à mi-chemin entre Mayunga et Tananarive, d’une cachexie paludéenne, un affaiblissement général dû à la malaria. Il disparaissait donc 2 mois après son copain Emmanuel, victime comme lui d’une maladie tropicale, victime surtout des aventures coloniales des hommes de la Troisième République.
Pour faire un peu de généalogie, notons que Gabriel David et Paul Brun ont un arrière-grand-père commun, Alexandre Brun, né vers la fin du XVIIIème siècle. Paul Brun est l’un des 23 MPLF inscrit sur le Monument aux Morts d’Ancone, disparu le 31 mai 1917 à Berry-le-Bac.