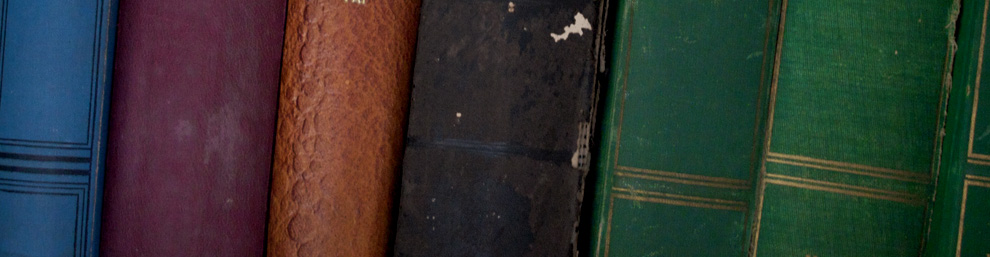115 noms de Poilus de Caderousse tombés lors de la Grande Guerre. 115 parcours qu’on va essayer de raconter au fil des semaines et des mois jusqu’au 11 novembre 2018.
Quatre-vingt huitième de la liste: Gabriel Joseph Marius RIEU.

La troisième face du Monument aux Morts.
Après deux biographies peu évidentes, voici donc une recherche plus facile pour Gabriel Rieu autant du point de vue généalogique que de celui du parcours militaire déjà évoqué à plusieurs reprises !
Gabriel Rieu est né à Caderousse le 07 novembre 1884. Son père, également prénommé Gabriel est cultivateur, né au quartier du Gabin, propriétaire suivant l’Etat-civil. Gabriel Rieu père épouse Rose Thérèse Marie Menu le 27 avril 1881 à Caderousse. Gabriel comme Rose ne sont pas à proprement parler de jeunes époux puisque respectivement âgés de 38 et 36 ans le jour de leur union. Certainement trop de travail pour Gabriel qui mène seul les terres de son père Jean, décédé en 1870. Les époux vont s’installer au Gabin.
Des enfants vont venir enrichir la famille de Gabriel et Rose. Gabriel fils est donc le premier enfant du couple, né trois ans après les noces, suivi en 1886 d’une fille prénommée… Gabrielle (Thérèse Jeanne) pour ne pas être trop original. Voici ce que raconte le recensement de 1886, quartier de Rabaisse, une autre appellation du Gabin certainement. Près du petit Rhône, il devait baigner souvent.

La mère de Gabriel père est toujours là. Les deux enfants Marius Gabriel et Thérèse Gabrielle -l’agent recenseur n’ayant pas osé écrire trois fois Gabriel- sont bien inscrits et deux jeunes hommes, Roche Louis et Gabriel aident le père dans le travail quotidien aux champs.
Quelques années plus tard, un petit Julien Louis Parfait vient compléter la fratrie, né en 1891. Petit dernier mais petit tout simplement, par la taille puisque l’Armée en 1901 le toisera à 1,55 mètre. Deux centimètres de moins que son « grand » frère Gabriel.

En 1896, l’agent recenseur se prend un peu les pieds dans le tapis en inventant une fille aînée Marie en lieu et place de Gabrielle et en inversant les âges. Un seul domestique aide le père dans son entreprise, un certain Paul Guissan qui gagne ainsi quelques sous en attendant d’être appelé sous les drapeaux.
Le 10 octobre 1905, Gabriel rejoint le 58ème Régiment d’Infanterie d’Avignon. Il y restera deux ans, libéré le 28 octobre 1907. Il est devenu Première Classe et a obtenu un Certificat de Bonne Conduite.
Il retourne à la grange, chemin d’Orange pour aider ses parents. On retrouve toute la famille en 1911, dernier recensement avant la guerre.

Une seule petite erreur dans l’année de naissance de Julien, 1892 au lieu de 1891 ! Pour le reste, tout va bien. Plus besoin de domestiques à la ferme puisque les enfants sont en âge de travailler. Par contre, la grand-mère Marie-Rose Bouschier a quitté ce monde. Ainsi va la vie…
Le 04 août 1914, Gabriel est rappelé sous les drapeaux. Il rejoint le régiment réserve du 58ème, le 258ème R.I. dont on a déjà tristement parlé. Oui, Gabriel va être le septième Caderoussien à perdre la vie dans la seconde quinzaine de septembre 1914 dans le secteur de Saint-Mihiel !
Après Louis Pécoul mort le 16 septembre, Paul Julien tué le 20, Justin Miaille le 26, Eugène Cambe disparu entre le 20 et le 27, c’est au tour de Gabriel Rieu de ne donner plus aucun signe de vie à partir du 27 septembre. Maurice Millet et Henri Lazard connaîtront le même sort, respectivement les 28 septembre et 04 octobre 1914 pour clore cette énumération funeste.
Le 27 septembre 1914, Gabriel Rieu était âgé de 29 ans et 11 mois. Son corps fut retrouvé par la suite et il repose désormais à la Nécropole Nationale « Vaux-Racine » de Saint-Mihiel.
Quant à son frère, un temps éloigné du front de part sa petite taille, il fut versé au 6ème Régiment d’Artillerie Lourde d’Orange pour y faire toutes les campagnes, de Verdun au Chemin des Dames et à Craonne, à la dernière offensive de Champagne en 1918. Mais lui eut la chance de retourner vivre auprès des siens, en 1919.

La fiche matricule de Gabriel Joseph Marius Rieu de Mémoire des Hommes.
Gabriel Joseph Marius Rieu, matricule 156 de la classe 1904, bureau de recrutement d’Avignon, pour ceux qui souhaitent aller consulter sa fiche matricule sur le site des Archives du Vaucluse. Le patronyme Rieu est encore assez présent en Vaucluse comme dans le Gard, si quelqu’un reconnaît en Gabriel Joseph Marius son ascendant indirect, qu’il n’hésite pas à se manifester pour compléter cette petite biographie.
A suivre… Antoine Ripert.